Le monde policier est, entre autres domaines, celui du renseignement, de la sécurité publique, du maintien de l'ordre. Et celui, bien sûr, de l'enquête de police judiciaire. Il suffit pour s'en convaincre de jeter un œil sur les programmes TV truffés de films et de séries où le policier traque inlassablement l'assassin.
Historien et membre de la SFHP, spécialiste de l'histoire criminelle, surtout connu du grand public pour ses biographies de criminels célèbres (dont celle de Violette Nozière), Bernard Hautecloque offre ici aux visiteurs de notre site un article inédit sur une affaire criminelle un peu oubliée aujourd'hui mais qui défraya la chronique dans les années 1950 et montra une fois de plus à quel point le fait divers oblige à un autre regard sur la société du moment.
(Récit de Bernard Hautecloque)
Si vous aviez la curiosité de
savoir de quoi ont parlé vos parents, ou grands-parents, en
découpant la dinde de Noël 1956 ou en versant des libations pour
saluer la nouvelle année 1957, vous pourriez parier, sans grand
risque de vous tromper qu’au réveillon, le principal sujet de
conversation fut l’Assassinat
des amoureux de Saint Cloud.
Une passionnante énigme policière, un des faits divers les plus
retentissants, et les plus significatifs, de la France des années
1950.

UN SINISTRE MATIN DE DÉCEMBRE
Enchâssé dans la banlieue
chic de l’Ouest parisien, le Parc de Saint-Cloud attire des
milliers de visiteurs à la Belle Saison. Mais, par un petit matin de
fin décembre, quand un brouillard persistant empêche le jour de se
lever, il perd beaucoup de son charme. A fortiori si on n’y voit
âme qui vive et si, en arrière plan, on entend un chien hurler à
la mort …
Telles étaient, du moins,
les réflexions que se faisait le gardien Michel, en allant prendre
son service, le samedi 22 décembre 1956. Tout de même intrigué par
le bruit, il remonta l’allée de la Félicité apercevant, sur le
côté gauche, un épagneul qui aboyait furieusement. Et lugubrement,
car c’était deux cadavres, étendus face contre terre, que gardait
Youki (c’était le nom gravé sur le
collier dudit chien).
On procéda aux premières
constatations. Les victimes étaient un homme et une femme, jeunes
(20-22 ans) et bien vêtus. Ils avaient été chacun tués de deux
balles de 7,65 dans la nuque, le crime remontant à la veille au
soir. En les voyant, le gardien-chef Milon s’exclama :
« Ma
parole, mais ce sont les amoureux d’hier !
Ils ont passé
presque tout l’après-midi, enfermés dans une 203 Peugeot.
– Et qu’y
faisaient-ils ?" lui demanda un policier.
Milon
haussa les épaules.
« Qu’est-ce que vous vouliez qu’ils y fassent ? Ils se
bécotaient, bien sûr … Gentiment, notez, rien de scabreux.
– Et ils étaient
garés où ?
– Exactement là où
on a découvert les corps. »
 Or, le même samedi matin,
dans une rue peu passante de Sèvres, on avait justement trouvé une
Peugeot 203 [voir photo ci-contre] abandonnée presque en travers de la chaussée. Deux de
ses vitres étaient brisées et ses sièges tachés de sang. Les
enquêteurs de la PJ établirent facilement que les deux amoureux
avaient été tués dans la voiture. Et par surprise, car ils
n’avaient pas eu le temps d’esquisser le moindre geste de
défense.
Or, le même samedi matin,
dans une rue peu passante de Sèvres, on avait justement trouvé une
Peugeot 203 [voir photo ci-contre] abandonnée presque en travers de la chaussée. Deux de
ses vitres étaient brisées et ses sièges tachés de sang. Les
enquêteurs de la PJ établirent facilement que les deux amoureux
avaient été tués dans la voiture. Et par surprise, car ils
n’avaient pas eu le temps d’esquisser le moindre geste de
défense.
Les deux victimes n’avaient
plus leurs papiers. Mais dans la 203, on trouva une carte grise
établie au nom d’Anita Soler, avec une adresse dans le XIVe
arrondissement. Et, sur le collier du chien qui refusait toujours de
s’éloigner, on lisait le nom du quadrupède, Youki,
et la même
adresse.
Bien qu’elle ait déjà
dépassé la soixantaine, Anita Soler (*1*) était une animatrice
de radio d’un certain renom.
Très émue, elle identifia les
cadavres sans l’ombre d’une hésitation : « C’est
ma petite Nicole (Depoué) !
Ayant perdu mon mari en 1951, j’avais alors fait venir Nicole
depuis Vouvant, en Vendée ; elle avait quinze ans. Avec le
temps, elle était devenue bien plus qu’une employée, presque la
fille que je n’ai jamais eue … Et lui, c’était Joseph
(Tarrago),
son amoureux. Quel monstre a pu s’en prendre à eux, comme cela ?
– Quand les
avez-vous vus pour la dernière fois ?
– Hier, vendredi 21
(soit le jour du
crime). Je n’aime
pas conduire dans Paris, et c’est surtout Nicole qui me sert de
chauffeur. Elle m’a déposée à la RTF, en début d’après midi,
rue Cognacq-Jay. Là, elle a rencontré Joseph, il y fait un stage
comme technicien, et avait son après-midi libre. Ils m’ont demandé
l’autorisation de prendre la 203 pour aller passer l’après-midi
au Bois, avec le chien Youki. Elle devait revenir me prendre après
l’enregistrement, à 18h30. »
– Et quand elle
n’est pas revenue, vous n’avez pas prévenu la police ?
– Bien sûr que
non ! Je me suis dit qu’elle et Joseph avaient été emportés
par la passion, si vous voyez ce que je veux dire … J’en ai
été quitte pour rentrer chez moi en métro. De mauvaise humeur, me
disant qu’ils auraient pu, au minimum, me prévenir. Si j’avais
pu me douter … j’espère qu’ils n’ont pas trop souffert … »
– Sur ce point au
moins, vous pouvez être rassurée : la mort a été quasi
instantanée. Ils n’ont eu le temps ni de souffrir ni même, sans
doute, de se rendre compte de ce qui leur arrivait. »
DOUBLE MEURTRE MYSTÉRIEUX
Les enquêteurs restaient
perplexes. Les portefeuilles des deux amoureux avaient disparu, mais
pas leurs montres ni le manteau de fourrure de Nicole. Le peu
d’argent qu’ils portaient sur eux justifiait-il un double
assassinat ? Et la façon presque professionnelle dont on les
avait exécutés (on leur avait même porté le coup de grâce)
n’était pas, non plus, la
façon
d’agir d’un fou.
Faute de mieux, on s’orienta
d’abord vers un crime passionnel. Un amoureux (platonique, car elle
était morte vierge) de Nicole qui n’aurait pas supporté qu’elle
lui préfère un autre. Bientôt cependant, les médecins légistes
purent annoncer que le couple avait été abattu par deux armes
différentes. Et donc, par deux tueurs, et non un seul. Cela rendait
maintenant la
thèse du crime passionnel peu vraisemblable.
Alors ? S’agissait-il
d’un règlement de comptes ? D’une affaire d’espionnage ?
D’un attentat politique (la guerre
d’Algérie venait d’entrer dans sa troisième année) ? On
passa au peigne fin le passé des deux victimes, sans rien trouver
pour consolider ces hypothèses. Nicole Depoué et Joseph Tarrago
avaient été deux jeunes gens sympathiques et sans histoires.
Ils n’avaient jamais été mêlés, même de loin, à aucune
affaire louche et ne s’intéressaient pas à la politique.
Anita Soler, elle, comme
nombre de personnalités du monde du spectacle, dans les années
1950, était une compagne de route du Parti Communiste. Et, deux mois
plus tôt, la « normalisation » de la Hongrie par les
troupes soviétiques avait remué bien des esprits. Avait-on abattu
sa protégée pour atteindre la vedette ? Les enquêteurs ne se
sentaient pas le droit de négliger la
moindre piste, fût-elle
improbable.
Autre énigme : pourquoi
avoir volé la 203, si c’était pour l’abandonner, moins d’un
kilomètre plus loin ? En démarrant, le voleur avait d’abord
zigzagué sur l’herbe du Parc. Et, en un trajet de moins de dix
minutes, il avait trouvé le moyen de renverser une poubelle et de
froisser son garde-boue… Comme s’il était ivre ; ou ne
savait pas conduire.
Ce double crime mystérieux
fit en tout cas la une des journaux, ravis d’avoir un sujet qui
passionnait leurs lecteurs, en cette trêve des confiseurs. Et
chacun, dans le métro, à la table familiale ou sur le zinc du
bistrot, d’élaborer sa thèse, d’expliquer à ses amis et
parents qui avait commis le crime et pourquoi.
On en était encore là
quand, le 8 janvier 1957, un livreur vint prendre, chez Monsieur
Pizon, grossiste en appareils électriques, dans le XVIIe
arrondissement de Paris, deux postes de radio, commandés une heure
plus tôt par téléphone. En partant, le livreur demanda qu’on
envoie la facture au magasin Diribarne, un client régulier de la
maison.
Rien que de très banal. Sauf
peut-être que le jeune homme portait un blouson de cuir noir,
des bottes pointues comme des couteaux, une banane luisante de gomina
… Et des lunettes de soleil qui ne s’imposaient vraiment pas en
ce maussade début janvier. Ce ridicule clone d’ Elvis Presley fit
s’esclaffer, presque ouvertement, tous les employés.
MONSIEUR LUNETTES DE SOLEIL
Le lendemain, nouveau coup de
téléphone :
– « Maison
Diribarne.
Excusez-moi, vous
nous avez envoyé la facture d’hier ?
– Ah non, pas
encore.
– Tant mieux, car
nous aurions besoin aussi de quatre électrophones, que vous mettrez
sur la même facture. On passera les prendre demain, à la première
heure. »
Et le lendemain revint le même
livreur, roulant des mécaniques d’un air « affranchi »,
le nez toujours chaussé de lunettes de soleil. « Tu
les enlèves pour dormir, au moins ? »
railla le patron. « Bon,
voilà la commande. Évidemment, c’est un peu lourd, mais on
va te donner un coup de main. T’es garé où ?
– Euh, en fait, je
suis venu en métro. »
Le patron fronça le sourcil.
Cette histoire commençait à lui paraître bizarre. « Dis
donc, au fait, avant-hier, j’ai oublié de te demander un reçu.
– Ah, mais, il faut
envoyer la facture au service comptabilité …
– Soit, mais je
voudrais au moins une trace que la marchandise a été livrée. En
tout, il y en a pour presque 400 000 francs (*2*)…
– Et vous avez
besoin d’un reçu pour 400 000 malheureux francs ? Mais
alors, vous êtes des minables ! »
Dressé sur ses ergots, le
livreur se fit insultant, agressif même. La discussion dégénéra,
au point qu’on finit par appeler la police. Il ne fallut pas une
demi-heure aux gardiens de la paix pour établir que Jean-Claude
Vivier (il avait ses papiers sur lui) n’avait jamais été employé
par la maison Diribarne. Et qu’il avait déjà commis nombre de
petites indélicatesses, aux dépens de ses patrons successifs.
Bref : ses achats d’électrophones et de radios n’étaient
que des tentatives d’escroquerie. Qui auraient d’ailleurs pu
réussir s’il n’avait pas commis l’imprudence de rééditer son
coup le lendemain.
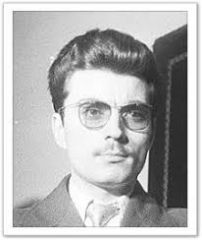 Au commissariat des
Batignolles, Vivier [voir photo ci-contre] continua à jouer les petits coqs, à nier
l’évidence pour le plaisir de compliquer les choses. L’inspecteur
perdit vite patience :
Au commissariat des
Batignolles, Vivier [voir photo ci-contre] continua à jouer les petits coqs, à nier
l’évidence pour le plaisir de compliquer les choses. L’inspecteur
perdit vite patience :
– Mets-toi à
table ! Pas de temps à perdre avec un minus comme toi !
– Moi, un minus ? »
rétorqua Viviers piqué au vif. « Celui
qui a fait le crime de Saint-Cloud, vous diriez que c’est un minus,
aussi ? Moi, je pense que c’est quelqu’un de très fort.
– C’est une
affaire qui donne du fil à retordre aux collègues »
reconnut le policier, mais
quel rapport avec toi ?
– Je vais vous le
dire, le rapport : c’est moi qui ai fait le coup !
– Menteur !
– Menteur ? Eh
bien, vérifiez un peu ce qu’il y a dans mon portefeuille ! »
triompha le jeune voyou.
Et de fait, dans son
portefeuille, qui n’avait pas encore été inventorié, on trouva
le permis de conduire de la victime, Nicole Depoué. Vivier l’avait
gardé comme trophée ; comme le « certificat de baptême »
du dur qu’il pensait être devenu. Cette fois, l’affaire
dépassait de beaucoup la compétence d’un commissariat de
quartier. Ce fut à la Brigade Territoriale qu’on emmena Vivier.
Celui-ci flatté qu’on s’occupe de lui comme jamais dans sa vie,
mais déjà un peu inquiet tout de même, précisa : « Attention :
j’étais à Saint-Cloud, mais ce n’est pas moi qui ai tiré.
C’est mon copain Jacques Sermeus. »
Jacques Sermeus fut arrêté
chez le cordonnier où il faisait son apprentissage. Contrairement à
Vivier, lui n’avait jamais eu affaire à
la Justice, mais d’une intelligence très basse (il savait à peine
lire et écrire), il s’avéra difficile à interroger. À son
domicile, on retrouva les pistolets 7,65 dont les
deux hommes s’étaient
servis.
UNE AFFAIRE DE ZOLD-UP
« Alors,»
voulut savoir le commissaire divisionnaire Dessaunay, « pourquoi
les avoir tués ? Vous les connaissiez ? Vous aviez des
raisons de leur en vouloir ?
– Euh, non. On
voulait leur voiture. Pour commettre des hold-up. (Vivier
prononçait : des
z-oldup)
– Si c’était pour
voler une voiture, il aurait été infiniment plus facile et moins
risqué d’en prendre une vide. »
Et l’histoire se fit jour,
navrante de stupidité. Nourris de films de série B, Vivier et son
acolyte avaient décidé de devenir des gangsters, comme ceux dont
ils admiraient les exploits sur grand écran. Et un gangster qui se
respecte, ça fait des « z-oldup »
dans une grosse voiture, on voit ça dans tous les cinémas.
 Or, ni Vivier ni Sermeus (voir photo ci-contre) ne
savaient conduire. Évidemment, prendre le volant sans permis était,
dès cette époque, un délit courant. Mais les voitures des années
1950 ignoraient la direction assistée, les vitesses au plancher, le
démarrage automatique, etc. Les conduire exigeait savoir-faire et
expérience. Et Sermeus, pour bien se faire voir aux yeux de son
camarade, avait affirmé savoir conduire. « Oui,
mais seulement les 203 Peugeot ! »
Or, ni Vivier ni Sermeus (voir photo ci-contre) ne
savaient conduire. Évidemment, prendre le volant sans permis était,
dès cette époque, un délit courant. Mais les voitures des années
1950 ignoraient la direction assistée, les vitesses au plancher, le
démarrage automatique, etc. Les conduire exigeait savoir-faire et
expérience. Et Sermeus, pour bien se faire voir aux yeux de son
camarade, avait affirmé savoir conduire. « Oui,
mais seulement les 203 Peugeot ! »
Les deux pieds nickelés
avaient donc passé tout l’après-midi du vendredi 21 décembre à
errer dans le Parc de Saint Cloud, pour chercher une 203. C’était
en 1956 un modèle très courant (*3*) et ils en repérèrent facilement plusieurs en stationnement. Mais
ces piètres voleurs n’auraient pas su la démarrer sans clé …
La nuit tombait déjà quand ils tombèrent sur celle des
deux amoureux, dont Nicole avait laissé tourner le moteur. Sans
doute pour chauffer un
peu l’habitacle.
Comme ils l’avaient vu dans
des dizaines de films, Vivier et Sermeus tirèrent, tous deux en
même temps, à travers les vitres. Mais, ce qu’ils n’avaient pas
prévu, c’était que la vue des cadavres, l’odeur de sang et de
poudre les feraient presque s’évanouir. Il leur fallut un énorme
effort de volonté pour allonger leurs victimes sur l’herbe,
chasser à coups de pied l’infortuné Youki avant de prendre la
route.
La voiture ne roulait pas
depuis vingt secondes que Vivier s’apercevait déjà à quel point
son ami s’était vanté : Sermeus ne maîtrisait pas le
véhicule qu’il venait de voler. Après avoir frôlé plusieurs
fois l’accident, il finit par caler, s’avouant incapable d’aller
plus loin. Les deux voyous n’avaient alors plus eu d’autre
ressource que de s’enfuir, sans tambour ni trompette, vers le métro
Pont de Sèvres …
Le crime ayant eu lieu sur le
territoire de la Seine-et-Oise, le procès s’ouvrit devant la Cour
d’Assises de Versailles, le 20 mars 1958. Les journaux y avaient
dépêché leurs meilleures plumes, mais cet énième « procès
du siècle » devait décevoir son public. Sur le fond, les
débats n’apportèrent rien de nouveau. Les accusés, dépouillés
de leurs oripeaux de faux durs, apparurent pour ce qu’ils étaient :
deux crétins immatures qui avaient voulu jouer aux gangsters.


 Aussi révoltant qu’il
soit, l’assassinat des Amoureux de Saint-Cloud était,
objectivement, loin d’être le crime le plus atroce de la
décennie (*4*).
Et des pauvres types qui tuent, presque gratuitement, pour prouver
aux autres et à eux-mêmes qu’ils sont des « durs »,
on en trouve à toutes les époques. Viviers et Sermeus furent,
pourtant, très durement stigmatisés
dans les colonnes des
journaux comme dans la rue.
Aussi révoltant qu’il
soit, l’assassinat des Amoureux de Saint-Cloud était,
objectivement, loin d’être le crime le plus atroce de la
décennie (*4*).
Et des pauvres types qui tuent, presque gratuitement, pour prouver
aux autres et à eux-mêmes qu’ils sont des « durs »,
on en trouve à toutes les époques. Viviers et Sermeus furent,
pourtant, très durement stigmatisés
dans les colonnes des
journaux comme dans la rue.
À chaque époque, ses vaches
sacrées et sa bien-pensance. Dix ans avant Mai 68, le bouc émissaire
dénoncé par toute la classe politique, de la Droite aux
Communistes, et par la quasi-unanimité de la société, c’était
cette jeunesse pourrie par la vie trop facile (Il
leur aurait fallu une bonne guerre !),
la sexualité de plus en plus libre, les films et les romans
immoraux (*5*),
cette musique barbare, le jargon franglais, ces accoutrements
grotesques (Ray-bans, blue-jeans, santiags …) venus
d’Amérique. L’assassinat des Amoureux de Saint-Cloud avait donné
une magnifique occasion d’assimiler, sans nuance, la « délinquance
juvénile » (autre article importé d’Outre Atlantique) à
toute cette culture « Salut
les Copains ! » (*6*),
alors à la veille de prendre son essor.
GÉNÉRATION PERDUE
Et à ces deux « monstrueux
dégénérés »,
on avait beau jeu d’opposer la jeunesse « saine »,
sympathique, honnête et travailleuse, incarnée par leurs victimes.
« Vraiment
trop injuste que le destin ait fait se rencontrer, dans la solitude
d’un crépuscule d’hiver, deux êtres aussi purs et ces deux
révoltantes petites canailles »
poétisa la presse.
Effondrés dans le box,
conscients d’avoir tout le monde contre eux, les deux assassins du
Parc de Saint-Cloud échangeaient des regards penauds, exprimaient
des regrets d’une voix sans conviction. Revenant sur leurs aveux,
et au dépit de toute vraisemblance, ils nièrent, très mollement,
avoir tiré, rejetant la responsabilité sur l’autre. Leurs
avocats (*7*), maîtres Planty (pour Vivier) et Mirisch (pour Sermeus)
essayèrent de susciter la pitié en rappelant que les deux hommes
avaient très tôt perdu leurs parents. Que c’était à
l’orphelinat d’ Audaux qu’ils étaient devenus amis. En vain.
« Toute la
compassion va à leurs victimes »
affirmaient les médias.
Ils furent condamnés à mort, à l’approbation générale.
Sermeus bénéficia de la grâce présidentielle. A l'aube du 6 août 1958, Vivier fut, lui, guillotiné dans la cour de la prison de la Santé.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTES
1- De son vrai nom Anna Biraud (1892-1965). Avec son mari, le célèbre
comédien André Delferrière (1884-1951), elle s’était fait une
spécialité des feuilletons radiophoniques, très populaires avant
l’ère de la télévision.
2- Il
s’agit de 400 000
francs anciens, bien sûr. Soit, mutatis mutandis, 7 000 €
de 2018.
3- En
1956, les voitures importées étaient chères et rares, et chaque
constructeur français ne proposait qu’un ou deux modèles.
Peugeot, par exemple, ne produisait que des 203 (de 1948 à 60) et
des 403 (de 1955 à 1966). On peut considérer qu’en 1956, sur les
quelque trois millions de voitures légères en circulation dans
toute la France (en 2016, il y en a presque trente millions …),
une sur dix était une Peugeot 203.
4- Sans
même parler des atrocités diverses (égorgements, viols et
tortures) qui ponctuaient, au même moment, de l’autre côté de
la Méditerranée, une guerre qui ne disait pas son nom.
5- Moins
de deux générations plus tard, il nous faut, certes, un gros
effort d’imagination pour comprendre combien les romans de
Françoise Sagan et les films de Brigitte Bardot faisaient alors
scandale …
6- « Salut
les Copains ! »
(significativement surnommé « Salut
les Voyous ! »
par ses détracteurs …) fut justement lancée en juillet 1959,
soit un an après le Procès de Versailles. Véritable phénomène
de société, la célèbre émission d’Europe n°1 symbolisa
l’émergence, pour la première fois de l’Histoire, d’une
culture (musicale, mais aussi vestimentaire, linguistique …)
spécifique à la jeunesse.
7- Notons
que René Floriot (1902-75), la star des avocats de l’époque, a
également participé au procès, mais en tant que partie civile.
Anita Soler l’avait engagé, pour « venger
la mémoire de ma petite Nicole ».

 Or, le même samedi matin,
dans une rue peu passante de Sèvres, on avait justement trouvé une
Peugeot 203 [voir photo ci-contre] abandonnée presque en travers de la chaussée. Deux de
ses vitres étaient brisées et ses sièges tachés de sang. Les
enquêteurs de la PJ établirent facilement que les deux amoureux
avaient été tués dans la voiture. Et par surprise, car ils
n’avaient pas eu le temps d’esquisser le moindre geste de
défense.
Or, le même samedi matin,
dans une rue peu passante de Sèvres, on avait justement trouvé une
Peugeot 203 [voir photo ci-contre] abandonnée presque en travers de la chaussée. Deux de
ses vitres étaient brisées et ses sièges tachés de sang. Les
enquêteurs de la PJ établirent facilement que les deux amoureux
avaient été tués dans la voiture. Et par surprise, car ils
n’avaient pas eu le temps d’esquisser le moindre geste de
défense.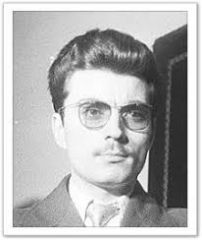 Au commissariat des
Batignolles, Vivier [voir photo ci-contre] continua à jouer les petits coqs, à nier
l’évidence pour le plaisir de compliquer les choses. L’inspecteur
perdit vite patience :
Au commissariat des
Batignolles, Vivier [voir photo ci-contre] continua à jouer les petits coqs, à nier
l’évidence pour le plaisir de compliquer les choses. L’inspecteur
perdit vite patience : Or, ni Vivier ni Sermeus (voir photo ci-contre) ne
savaient conduire. Évidemment, prendre le volant sans permis était,
dès cette époque, un délit courant. Mais les voitures des années
1950 ignoraient la direction assistée, les vitesses au plancher, le
démarrage automatique, etc. Les conduire exigeait savoir-faire et
expérience. Et Sermeus, pour bien se faire voir aux yeux de son
camarade, avait affirmé savoir conduire. « Oui,
mais seulement les 203 Peugeot ! »
Or, ni Vivier ni Sermeus (voir photo ci-contre) ne
savaient conduire. Évidemment, prendre le volant sans permis était,
dès cette époque, un délit courant. Mais les voitures des années
1950 ignoraient la direction assistée, les vitesses au plancher, le
démarrage automatique, etc. Les conduire exigeait savoir-faire et
expérience. Et Sermeus, pour bien se faire voir aux yeux de son
camarade, avait affirmé savoir conduire. « Oui,
mais seulement les 203 Peugeot ! »
 Aussi révoltant qu’il
soit, l’assassinat des Amoureux de Saint-Cloud était,
objectivement, loin d’être le crime le plus atroce de la
décennie (*4*).
Et des pauvres types qui tuent, presque gratuitement, pour prouver
aux autres et à eux-mêmes qu’ils sont des « durs »,
on en trouve à toutes les époques. Viviers et Sermeus furent,
pourtant, très durement stigmatisés
dans les colonnes des
journaux comme dans la rue.
Aussi révoltant qu’il
soit, l’assassinat des Amoureux de Saint-Cloud était,
objectivement, loin d’être le crime le plus atroce de la
décennie (*4*).
Et des pauvres types qui tuent, presque gratuitement, pour prouver
aux autres et à eux-mêmes qu’ils sont des « durs »,
on en trouve à toutes les époques. Viviers et Sermeus furent,
pourtant, très durement stigmatisés
dans les colonnes des
journaux comme dans la rue.
Commentaires
Une lecture agréable et très instructive sur le système policier et judiciaire de la France des années 1950. Cette affaire est relatée de manière vivante et drôle même si c'est loin d'être un léger fait divers.
MelliouMerci pour votre récit. Dans votre description de l'arrestation de Vivier, j'ai quelques précisions à vous apporter.
En premier lieu, la société Pizon Bros n'était pas seulement grossiste mais c'était avant tout un fabricant innovant de radio et de télé (les premiers postes à transistor, mini téléviseurs utilisés comme moniteurs aux journaux télévisés, réveils radio électriques, etc). C'était une marque célèbre, fabriquée en région parisienne, dans l'usine dirigée par un autre des quatre frères Pizon (d'où le "Bros" pour brothers). Vivier voulait donc des produits qu'on dirait "nouvelles technologies" et "early adopter" aujourd'hui
En second lieu, c'est la cheffe du service des ventes qui a très vite compris que le bon de commande était faux. Pas tant à cause de l'attitude du pseudo-livreur, mais simplement parce qu'elle était connaissait bien les habitudes de ses clients ; les quantités et le choix des produits l’ont alertée et l’ont amenée à vérifier le bon de commande. Pizon Bros faisant face à beaucoup de tentatives d'escroquerie, elle était dans sa mission. C'est donc elle qui a informé le patron, et qui a prévenu quand Vivier a repassé "commande". La souricière a bien sûr été montée sur ordre de Mr Pizon. C'était facile puisque le service des ventes se trouvait au premier étage, sans ascenseur ; le personnel a laissé entrer Vivier et l'a cerné dans l'escalier quand il a voulu descendre au stock du rez-de-chaussée pour enlever la marchandise
CarolineJusqu'au moment où l'arme a été découverte sur Vivier, aucun employé, y compris ma mère puisque c'est d'elle qu'il s'agit, n'avait compris à quel point l'individu était dangereux. Ils pensaient coincer un petit escroc. Elle m'a avoué qu'ils n'auraient jamais tenté de l'arrêter s'ils l'avaient su armé. Voici le récit que m'a fait Eliane Merlande.